Derrière les droits de douane de Trump, un plan plus radical ? Voici notre hypothèse !
Une théorie qui pourrait changer la compréhension de la politique économique mondiale (ou pas !)

Depuis l’annonce par Donald Trump de nouveaux droits de douane de 25 % sur le Mexique, le Canada, et 10% pour la Chine une question taraude les observateurs : pourquoi cette mesure soudaine ? Officiellement, il s’agirait de lutter contre l’immigration clandestine et le trafic de drogue (Fentanyl). Mais ces justifications semblent être de simples prétextes : il n’y a pas d’immigration clandestine en provenance du Canada (l’inverse est vrai), et seulement 0,5% des prises de Fentanyl aux Etats-Unis sont en provenance du Canada.

Par ailleurs, personne ne l’a souligné, mais la sécurité d’une frontière intérieure incombe au pays en question : pourquoi le Canada paierait-il pour la sécurité de la frontière américaine !!!!!???????
Donald Trump impose des droits de douane comme un chef d’orchestre : il tape sur les cymbales, mais on a un peu du mal à comprendre la mélodie. Que cachent les mesures de Trump… ? Tout le monde se demande quel « effet levier » il cherche à obtenir ; quelle négociation est en cours ? Cette hypothèse de « l’effet levier » a même été validée par Trump lui-même et certains de ses lieutenants.
Mais, on sait depuis son élection en novembre que Trump a décidé de frapper fort et vite. Et si… il était était en train de préparer quelque chose de beaucoup plus radical que ce que les observateurs attendent ? Et si ces droits de douane ne servaient pas à négocier quelque chose, mais étaient au contraire destinés à rester en place définitivement, et à s’étendre progressivement à tous les partenaires commerciaux des États-Unis ? C’est une hypothèse que je vous présente : Trump ne serait pas simplement protectionniste, il voudrait en finir avec la globalisation et redéfinir un ordre économique mondial.
Trump cherche-t-il à négocier ou à briser le libre-échange ?
Historiquement, le protectionnisme a souvent été utilisé comme un levier pour renégocier des accords commerciaux. Mais Trump semble suivre une toute autre logique : il ne semble pas du tout négocier (surtout des choses non-négociables, comme la traque d’un Fentanyl canadien qui n’existe pas) : peut-être souhaite-t-il imposer un nouveau modèle économique basé sur le fait que les Etats-Unis peuvent atteindre une certaine autosuffisance nationale.
Et si les droits de douane qu’il applique à la Chine, au Mexique, au Canada (et, potentiellement, à l’Union européenne) ne sont pas conçus comme un moyen de pression, mais comme un nouveau standard. Il ne s’agirait plus de corriger un déséquilibre commercial, mais de mettre fin à la globalisation telle qu’on la connaît.
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large de « déglobalisation« , qui, si elle se confirme, pourrait bouleverser l’économie mondiale autant que la révolution industrielle ou la globalisation des années 1990-2000.
D’ailleurs, depuis des mois, on parle déjà de « dédollarisation de la planète » : certain pays réalisent désormais leurs échanges dans d’autres monnaies (à commencer par la Russie qui y est forcée). Certes, Trump menace ceux-là de rétorsion, et il ne facilitera jamais la dédollarisation. Mais il y a un état de fait : de nouveaux superpouvoirs sont nés (avec la Russie est la Chine en tête). Et puis, le repli national n’est pas (du tout) une nouveauté ou une surprise au nombre des propositions politiques de Trump.
« Une minute avant que les droits de douane ne soient imposés, les Canadiens ne comprenaient toujours pas pourquoi on voulait les punir. Et ils ne comprennent toujours pas pourquoi », rappelle Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l’université de Paris-Assas, spécialisé dans la politique et la société américaines. « Vous avez probablement raison, ça fait partie d’une volonté nationaliste, mais je pense que ça n’ira nulle part. Je crois que Trump et Musk sont des milliardaires qui s’embêtent et font de la politique de comptoir. Ils se croient des grands esprits intelligents mais ce n’est pas donné à tout le monde. C’est Donald Trump qui avait renégocié lui même le traité avec le Canada et le Mexique, donc aujourd’hui il se fait une guerre à lui-même. Par ailleurs, il applique seulement 10% de droits de douane à la Chine, alors que les Etats-Unis ont 1000 milliards de déficit avec ce pays, je ne trouve pas ça cohérent.
Je suis assez d’accord avec vous sur ses objectifs, mais ce n’est pas du tout certain qu’il aille jusqu’au bout ; il peut très bien reculer en disant qu’il a négocié quelque chose avec les pays visés ; après s’être rendu compte de son erreur. Un certain nombre de gouverneurs et d’élus républicains vont lui faire comprendre ».
Déjà, le réputé conservateur Wall Street Journal a titré dimanche : « La plus débile guerre commerciale de l’histoire ». Sauf que, ça ressemble à une guerre commerciale, mais ça n’en est pas forcément une. C’est peut-être simplement une nouvelle politique. Il ne faut pas oublier que Trump et Musk souhaitent coloniser la planète Mars : ils voient les choses en très très grand.
« La fin de la fin de l’histoire » : un retour à la nation ?
La globalisation était censée incarner « la fin de l’histoire« , selon la célèbre théorie de Francis Fukuyama. Mais si Trump s’engage dans cette voie (qui n’est pour le moment que notre théorie), nous pourrions alors assister à « la fin de la fin de l’histoire » : la fin d’une économie mondialisée au profit d’un retour à des États plus autosuffisants, fonctionnant sur une base nationaliste et protectionniste (en tout cas pour les pays qui peuvent se permettre l’autosuffisance).
Elon Musk, un indicateur des tendances du « nouveau trumpisme » ?
Le trumpisme oscille entre plusieurs courants idéologiques : d’un côté, les ultralibéraux, soutenus par exemple par le président argentin Javier Milei, qui prônent un capitalisme sans barrières ; de l’autre, un nationalisme conservateur très ancré dans la logique « America First ».
La personnalité d’Elon Musk incarne cette ambiguïté. D’un côté, il soutient le maintien des visas H-1B, favorisant l’immigration qualifiée, ce qui semble contradictoire avec la ligne dure de Trump sur l’immigration. De l’autre, Musk affiche un soutien ouvert à des figures de l’ultra-nationalisme comme Tommy Robinson au Royaume-Uni ou encore l’AfD en Allemagne.
Peut-être la campagne de Trump aurait caché un nationalisme plus défini et radical que ce qu’elle laissait percevoir. Si mon hypothèse se vérifie, alors Trump ne se contenterait pas d’être protectionniste : il serait sur le point de créer une révolution économique « nationaliste » qui pourrait en conséquence influencer d’autres nations. L’impact potentiel serait en effet gigantesque : d’autres pays pourraient suivre ce modèle, menant à une fragmentation du commerce international. Si, comme le souligne Jean-Eric Brannaa, et seulement si… Trump peut aller jusqu’au bout de sa révolution.
L’exemple russe ?
Les récentes sanctions occidentales, ces dernières années, contre la Russie avaient comme objectif d’affaiblir son économie. Pourtant, elles ont conduit à un effet inverse : la Russie a largement remplacé ses importations par une production nationale, gagnant en autonomie économique. En quelques mois, elle est devenue moins dépendante des flux mondiaux (même si, ne pouvant pas tout créer elle même, elle a bien évidemment aussi dû tisser de nouveaux partenariats internationaux sur tous les continents).
Bien sûr, les USA ne sont pas la Russie et ils pourraient peut-être plus facilement gagner en autonomie. Mais non sans mal. Trump commence à évoquer que ces mesures pourraient bien être « douloureuses » pour les Américains. Ainsi, si ma théorie est avérée, Trump saurait que son programme va créer un choc inflationniste et une période de turbulences économiques. Mais il parierait en contrepartie sur une réindustrialisation rapide qui conduirait alors, pour lui, à sa récente promesse d’accéder à « l’âge d’or de l’Amérique ». Comme dit l’adage… on ne fait pas d’âge d’or sans casser des œufs !
Alors, pourquoi laisser planer l’idée d’un « effet levier » ? D’une négociation ?
Peut-être pour des raisons légales. Pour imposer des droits de douane en dehors des cadres classiques (OMC, accords bilatéraux), Trump invoque un état d’urgence national. Il l’a déjà fait en 2018-2019 pour justifier des tarifs sur l’acier et l’aluminium sous prétexte de « sécurité nationale » (Section 232 du Trade Expansion Act de 1962). Si cette stratégie est réutilisée aujourd’hui, cela indiquerait une volonté assumée de se détacher des règles du commerce international par ce prétexte puis, progressivement, de forcer à la fin (ou la renégociation) des traités en place.
Pas une bonne nouvelle pour l’Union Européenne
Si Trump pousse cette logique à son terme, quelles seraient les conséquences pour l’Union européenne ? L’UE repose sur un modèle basé sur le libre-échange et les accords commerciaux internationaux. Sans globalisation, l’UE perd une partie essentielle de son intérêt économique.
Certaines nations européennes, notamment l’Allemagne, extrêmement dépendante de ses exportations, souffriraient énormément d’un réalignement protectionniste mondial. Des tensions internes pourraient alors fragiliser l’Union.
Si, depuis des années, de nombreuses voix s’élèvent dans des pays d’Europe, assurant que les citoyens payent trop fort le « prix de la mondialisation », que penseraient-ils si l’Union Européenne continuait la mondialisation alors même que les USA en sortent ?
Certes ce n’est qu’une théorie et, pour le moment, la mondialisation se poursuit, avec même un accentuation de +3% des échanges commerciaux mondiaux l’an passé. Et puis, les Anglo-Saxons sont depuis des siècles les promoteurs d’une mondialisation qui leur est favorable : ils protègent leurs voies commerciales sur la planète. Mais, si on commence à parler en terme « d’Anglo-Saxons », alors on peut noter qu’actuellement l’Angleterre est en train de vivre un désastre économique, et que les Allemands ont une économie qui vacille…
De toute façon, un repli nationaliste ne serait pas pour les Anglo-Saxons (s’il devait advenir) contradictoire avec la protection de leurs intérêts planétaires.
Trump peut-il réussir ?
La question centrale reste : cette stratégie est-elle viable ?
- Les États-Unis ont-ils les infrastructures pour réindustrialiser rapidement ?
- Les consommateurs américains accepteront-ils une inflation, même temporaire, en échange d’un retour à une production nationale ?
Une baisse drastique des impôts pourrait par exemple contrebalancer l’inflation et la colère qu’elle déclencherait chez les électeurs (y compris et surtout les Républicains).
En tout cas, si Trump parvenait à imposer ce modèle, cela signifiera la fin de la globalisation comme nous la connaissons. L’économie mondiale entrerait alors dans une nouvelle ère.
Est-ce que, ce que nous voyons aujourd’hui, est l’événement économique le plus marquant de la décennie ? Un autre indice : Trump assume aujourd’hui d’avoir déclenché une forte colère chez les Mexicains et les Canadiens. Certes, il aime le combat et certaines formes d’impopularité. Mais là, quand même, ça va très loin. Et ce serait étonnant qu’une guerre commerciale soit déclenchée comme ça, juste pour le plaisir ou pour quelques immigrés clandestins ayant passé la frontière canadienne.
Ainsi, ce serait une bonne nouvelle pour les Canadiens et Mexicains qui se sentent insultés : finalement ils ne seraient pas tout seuls à être visés par ces mesures !
Gwendal GAUTHIER
N’hésitez pas à venir critiquer ou discuter de cette théorie sur nos pages Facebook Le Courrier de Floride et Le Courrier des Amériques !
M.AJ : Ce lundi matin, Trump nous donne raison : il ne parle plus même de « Fentanyl Canadien » ou « d’immigrants », mais bien de commerce :
PUBLICITE :




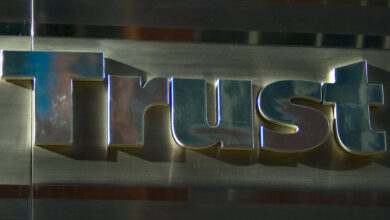
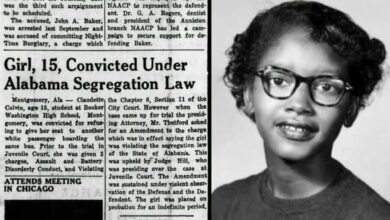





Oh que dire de ce chef d’État qui menace tout un chacun. Je ne commenterai pas mais je laisse cette entrevue faite avec un journaliste de la vieille garde que je trouve très intéressante. A vous de la publier ou non, elle n’est pas récente mais il a très bien cerné le personnage à mon avis…
https://youtu.be/ZVNZ9rOvn6g?si=SdpTNpPv8e_Lwah4