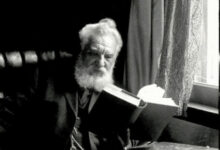« L’Amérique éclatée » de Romuald Sciora : critique d’un essai avec un tout petit intérêt
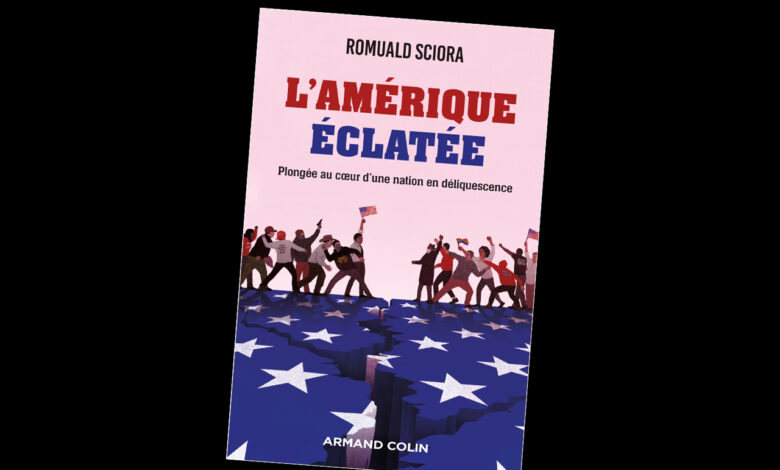
Le Courrier des Amériques essaye de lire de temps en temps des ouvrages critiques sur les États-Unis — et parfois franchement anti-américains. Ici, ce n’est pas tout à fait le cas : Romuald Sciora est d’ailleurs naturalisé américain. Cela dit, il pourrait sans doute être qualifié “d’anti-américain d’honneur”, tant son essai L’Amérique éclatée (Armand Colin, 2025) propose une vision sombre, désespérée, et souvent caricaturale du pays.
Sciora n’est pas beaucoup plus intéressant que d’autres auteurs du genre, et il est en tout cas nettement moins drôle que les plus caricaturaux des anti-américains.
Il y a quelques erreurs… mais passons
On ne va pas s’attarder sur les erreurs du livre, mais certaines affirmations sont si surprenantes qu’il faut les relever. Par exemple, l’auteur raconte qu’un homme au Colorado se serait vu refuser l’achat d’une maison… qu’il payait comptant, simplement à cause d’un credit score trop bas. C’est hautement improbable : lorsqu’un achat se fait sans emprunt, le score de crédit n’a aucune raison d’être pris en compte. Ca ressemble plus à un fait divers qu’à autre chose, mais en tout cas aucunement à une tendance.
Il qualifie aussi le politologue Samuel P. Huntington d’« associé à la droite », ce qui est pour le moins ambigu voire inexact (si le but est de faire passer Huntington pour quelqu’un de droite) : Huntington a toujours voté démocrate, selon son épouse. Son œuvre a certes été interprétée par certains conservateurs, mais cela ne suffit pas à en faire un penseur de droite.
Par contre il ne paraît pas superflu de préciser que l’auteur de ce livre, Romuald Sciora, n’est pas du tout de droite.
Une longue introduction historique façon Wikipédia
Les 80 premières pages de L’Amérique éclatée sont consacrées à un survol de l’histoire politique américaine, depuis la fondation du pays. C’est une tentative de contextualisation louable, mais dont le ton scolaire et la structure linéaire évoquent franchement une fiche Wikipédia.
Il n’y a rien de faux, mais rien de neuf non plus. Sciora ne propose aucune grille de lecture originale, aucune reformulation marquante.
Une analyse intéressante sur l’affaiblissement de l’État fédéral
Ensuite il y a une partie intéressante dans laquelle Sciora développe une thèse démontrant que, en raison de sa structuration historique, l’État fédéral américain est en perte d’influence, de légitimité, et même de contrôle sur son propre territoire.
Depuis les années 1980, et particulièrement depuis les années 2000, les gouverneurs des États américains ont accru leur autonomie politique face à un État fédéral de plus en plus affaibli, en profitant de la paralysie croissante du Congrès, de l’extrême polarisation idéologique, et de l’impuissance relative des présidents. Cette dynamique s’observe très clairement dans des États comme la Floride, le Texas ou la Californie, où les gouverneurs ont mis en œuvre des politiques qui ne tiennent plus compte d’une ligne fédérale commune. Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, a imposé des lois spectaculaires sur les questions d’éducation, de genre et de gestion des bibliothèques scolaires, qui ont suscité l’opposition du gouvernement fédéral, mais sans conséquences concrètes. Durant la Covid, lui et d’autres gouverneurs adoptaient des lois à l’opposé des directives fédérales. Greg Abbott, au Texas, a mobilisé la garde nationale pour gérer l’immigration, fermer la frontière américaine, et s’est régulièrement opposé publiquement à l’administration Biden, en particulier sur la politique migratoire. Les gouverneurs républicains ont par exemple détourné des flux d’immigrés vers des villes démocrates. À l’inverse, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, s’est dressé en travers de la route de Donald Trump, au point où celui-ci a menacé en 2025 de le faire arrêter et a envoyé l’armée faire face à des manifestants brandissant le drapeau d’autres pays (Mexique ou « République de Californie »).
Certains gouverneurs ne se contentent plus d’exécuter une politique nationale : ils se comportent comme des leaders politiques à part entière, voire des contre-pouvoirs ou des présidents régionaux. La tendance est accentuée par la Cour suprême, qui ne cesse de renvoyer aux États la responsabilité de légiférer sur des sujets majeurs comme l’avortement, les armes à feu ou la régulation économique. Ce morcellement juridique et politique de l’espace américain n’est pas nouveau, mais il produit un effet concret : un citoyen ne vivra pas la même Amérique selon qu’il naît au Massachusetts ou au Mississippi. C’est ce que Sciora décrit avec justesse comme une forme de désagrégation silencieuse de l’unité nationale. Ajoutons les tentatives de destitution de présidents qui sont souvent réduits à une impuissance politique intérieure contrastant avec leur hyper-puissance en matière de politique internationale.
Cette dynamique s’est amplifiée avec la crise de la COVID, la question migratoire, ou encore le droit à l’avortement, renvoyé aux États. La Cour suprême, en limitant les pouvoirs du gouvernement central, n’aide pas à l’unité nationale.
On notera toutefois une volonté de Donald Trump d’assainir le système électoral au niveau national (puisqu’il s’est dit victime d’une « triche » en 2020) (1).
AJOUT LE 15 AOÛT A NOTRE TEXTE D’ORIGINE :
Le déploiement en août 2025 de la Garde Nationale dans la capitale fédérale (Washington, D.C) valide la thèse de la fragilisation du pays mais ça illustre aussi la volonté du président Trump de reprendre en main la situation.
Sciora ne pousse pas la comparaison dans ce sens, mais le lecteur pense forcément aux républiques confédérées instables, ou aux États-Unis d’avant la guerre de Sécession. C’est une thèse inquiétante et dont il est difficile de démontrer le contraire, sauf en rappelant que c’est un peu toute l’histoire des Etats-Unis qui est ainsi façonnée, ce n’est pas nouveau. Mais depuis la Guerre Civile les velléités d’indépendance sont extrêmement marginales. Prétendre le contraire c’est renforcer d’ineptes théories du complot : les Américains ont certes des positions politiques moins harmonieuses qu’avant, plus antagonistes, mais pas forcément plus violentes que dans un pays comme la France.
Une critique sociale façon Bernie Sanders
La dernière grande section du livre est consacrée à la critique sociale : pauvreté structurelle, effondrement de l’éducation publique, inégalités raciales, services de santé hors de prix, ghettoïsation, violence, travail précaire…
C’est beau comme du Garrido (Raquel) : du Bernie Sanders pur jus — ou presque. Romuald Sciora fait un constat très proche de celui des sociaux-démocrates américains : une économie qui produit beaucoup mais redistribue mal, des services publics affaiblis, une jeunesse surendettée, une société fracturée où la précarité rôde même dans les classes moyennes.
Sur ces points, plus on aligne de mots (et de maux) et plus le constat est… consternant. Ceux qui n’ont jamais lu Bernie Sanders découvriront sans doute des réalités qu’ils ignoraient. Mais ni Sciora ni Sanders ne commencent par l’essentiel : Les États-Unis restent, malgré tout, l’économie la plus performante de la planète. C’est une vérité gênante pour ceux qui veulent ne voir que l’échec américain. Mais elle est indispensable pour comprendre le pays : c’est cette tension entre réussite économique et échec social qui est aussi bien complexe à comprendre qu’à régler. Si l’on ne voit que du malheur, ou que du bonheur, on passe à côté de l’Amérique. Et aussi de ses tragédies.
Les divisions politiques américaines sont certes assez spectaculaires depuis 15 ans, mais des «intellectuels» et journalistes français en tirent des conclusions très peu rationnelles. On est encore et toujours dans « la fin de l’empire américain ! »… qui n’en finit pas de finir !
Gwendal Gauthier
directeur du Courrier des Amériques
1 – Sans jamais vraiment prouver ses accusations. Mais en tout cas s’il peut améliorer le système électoral alors pourquoi pas !