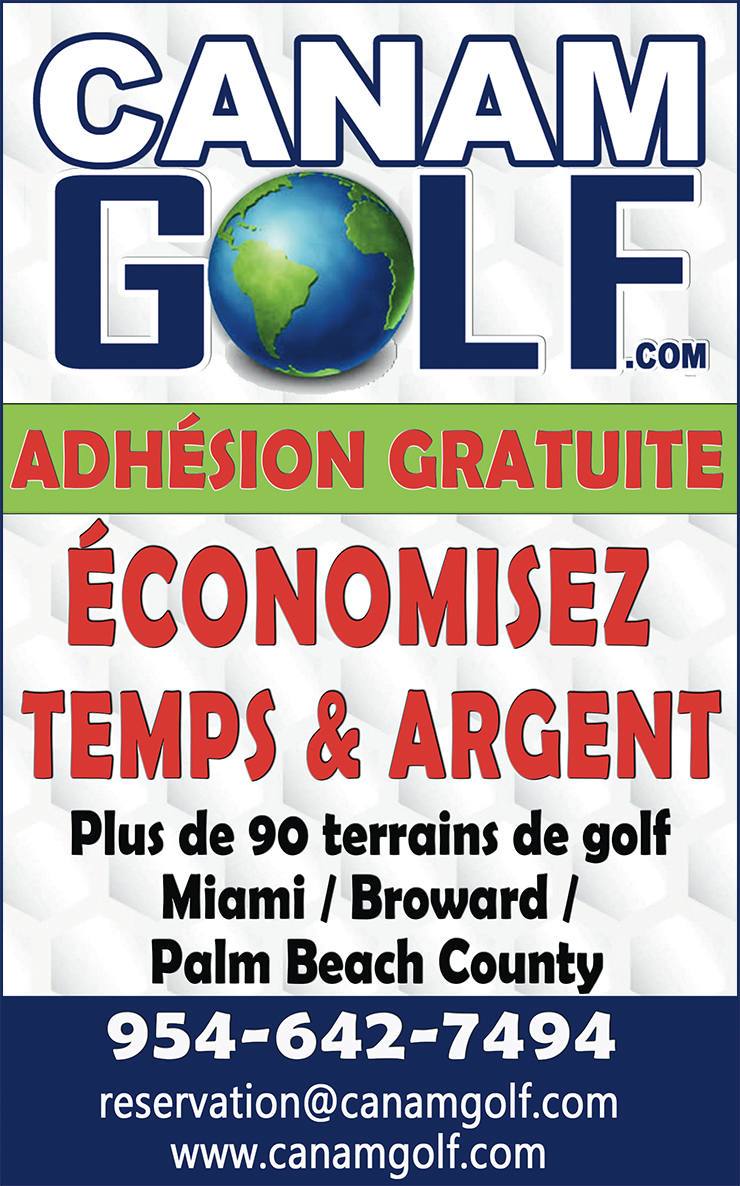SnowBird Livraison de Voitures : pour transporter vos véhicules entre le Canada, Floride, Arizona…

Dans le monde occupé des services de livraison de voitures « convoyage » (drive-away), SnowBird Livraison de Voitures (Snow Bird Car Delivery) se distingue par un service personnalisé et fiable. « Basés à Ottawa et à Fort Lauderdale, nous desservons fièrement le Québec, l’Ontario et les provinces de l’Atlantique, avec une attention particulière au marché franco-canadien. Notre objectif est d’offrir un transport de véhicules fiable tout en fournissant un excellent service dans toutes les régions que nous couvrons. »
Utilisation de la Technologie
Les conducteurs sont équipés de dispositifs de suivi GPS et d’écrans portables dotés de caméras avant et arrière avec verrouillage en cas de collision. Ils utilisent Waze et Google Maps pour la navigation, assurant des itinéraires efficaces et des arrivées ponctuelles. Cette configuration aide à garantir que les paramètres audio de votre véhicule restent intacts, vous permettant de profiter de vos configurations préférées sans aucun ajustement.
Sélection et Soutien des Conducteurs
Pour garantir la sécurité, « nous limitons la conduite à 12 heures par jour et exigeons que nos conducteurs se reposent dans des hôtels ou des motels. Cette approche permet à nos conducteurs de rester bien reposés, alertes et en sécurité. Tous nos conducteurs sont personnellement connus de nous, sélectionnés pour leur conduite prudente et expérimentée, et détiennent des adhésions Premium CAA avec des avantages AAA pour offrir un soutien supplémentaire si nécessaire. »
— Jacques Tremblay, client satisfait
Service Complet
SnowBird Livraison de Voitures (SnowBird Car Delivery) offre une gamme de services, y compris le transport d’animaux de compagnie et des options de chauffeur VIP. Que vous ayez une voiture de luxe, un véhicule de performance, un véhicule électrique (EV) ou un VR, ils les traitent avec soin. « Chaque véhicule est suivi grâce à notre technologie et est retourné propre, détaillé et désinfecté. »
Traitement Équitable et Rémunération Compétitive
« Nous croyons en un traitement respectueux de nos conducteurs et offrons une rémunération équitable. Cela garantit que nos conducteurs peuvent fournir un excellent service sans avoir à réduire les coûts ou à conduire pendant des heures excessivement longues. »
Courtage et Douanes
Avec leurs propres comptes de courtage et de douanes, ils gèrent tous les documents nécessaires de manière fluide, éliminant tout tracas lié au processus de transport.
Zones de Service
Ils transportent des véhicules vers des destinations telles que la Floride, la Géorgie, les Carolines, Denver, l’Arizona et la Californie. « Nos zones de service comprennent également le Québec, l’Ontario et les provinces de l’Atlantique. »
Un Engagement envers l’Excellence
SnnowBird Livraison de Voitures (SnowBird Car Delivery) est dédiée à l’utilisation de la technologie, à la sélection minutieuse des conducteurs et à une large couverture pour fournir un transport de véhicules fiable. « Notre vision est de devenir le premier choix du Canada pour les services de livraison de véhicules drive-away. »
Pour plus de détails ou pour demander un devis, visitez le site https://fr.snowbirdcardelivery.com ou connectez-vous avec nous sur www.facebook.com/SnowBirdCarDelivery/. Pour des demandes directes, contactez John Hennessy au (819) 271-6305, Bob Quesnel au (613) 292-3279, ou envoyez un courriel à snowbirdcars@gmail.com. Nous avons hâte de vous servir.